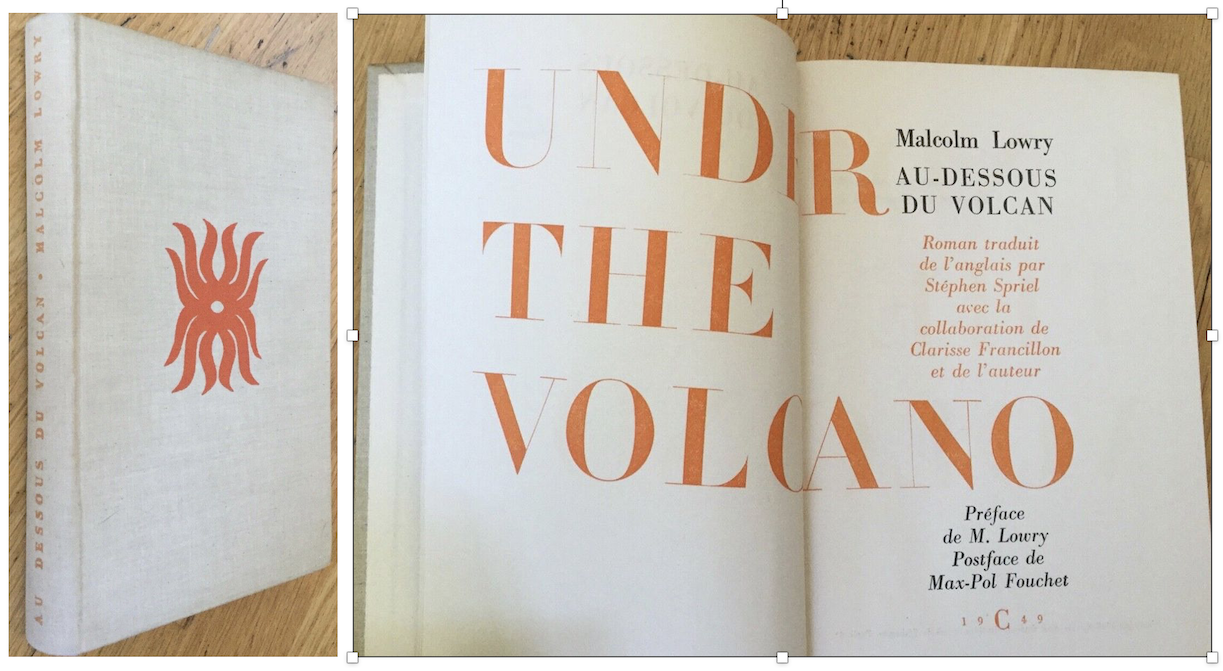Je trouve que cet article est une explication, une sujétion d'explication qui nous permet de comprendre le travail de Hans Bellmer.
Je vous le livre.
"L'autre corps
Vous êtes devant le miroir. Vous ne voyez que votre visage. C’est l’habitude. Mais le miroir, qui le voit? Qui y pense? Vous vous dites : je vais regarder le miroir – regarder sa surface et non pas mon reflet. Les yeux, très vite, font mal, ou les tempes, ou le creux des orbites. Vous insistez quand même. Alors monte un drôle de brouillard, qui rend toute chose indécise, tremblée, diffuse. Sans doute, vous abandonnez là, mais vous restez à la question. Aussi, un jour ou l’autre, vous recommencez l’expérience. Vous revoyez le brouillard, vous essayez de tenir encore, de voir plus loin. Et soudain, quelque chose vient : une forme, un visage d’après la mort, le vôtre. Peut-être ne recommencerez-vous jamais plus; peut-être apprendrez-vous à traverser votre peur. Toute rencontre, n’est-ce pas, se fait au milieu d’un pont. Qui vient là? Vous et Lui, de chaque côté, avez le même chemin à faire, le même temps pour vous reconnaître. Et voici à peu près ce qui vous arrive : du brouillard émerge une forme, de la forme émerge quelqu’un, de ce quelqu’un émerge Vous, et de Vous émerge un crâne vide – un squelette. Et chaque fois la forme remplacée s’en va disparaître vers le fond, mais comme un cercle sur de l’eau, en ridant tout l’espace vers l’extrême duquel elle s’efface, de telle sorte que, une seconde, ce qui n’est plus là est tout de même encore là. Quand vous revenez à vous, à l’habituelle vision de votre reflet, c’est à la manière dont le plongeur se retrouve sur le tremplin si l’on passe le film à l’envers. Vous pouvez jouer ainsi avec votre miroir, et apprendre à lire votre mort – apprendre à fixer les instants de la décomposition et de la recomposition. Vous pouvez également en tirer quelques principes. D’abord que l’espace n’est ni un contenant ni un contenu, mais le champ d’une tension; ensuite que le temps est lié tout entier à l’effacement : qu’il en est la trace. Le temps, c’est l’ombre de vous-même qui s’éloigne de vous et devient l’Autre, comment l’appeler? Un nom ne suffit pas. Il y faut une formule, celle-ci peut-être, qui est un peu barbare : Je ne suis pas je, je est l’Autre. Mais, sitôt posée, cette formule implique sa réversibilité, et vous voici tout à coup en possession de la seule clé qui pourrait rendre les choses fixes, remettre des yeux dans les orbites vides ou rendre un corps à votre amour perdu. Et si la réversibilité n’existe pas, ou bien si elle nous échappe, il n’y a qu’à l’IMAGINER. Qu’est-ce qui nous fait écrire des traits ou bien tracer des mots, sinon la nécessité de cette imagination-là? Et cela pour produire des choses qui commencent et re-commencent. Mais latente partout, cette imagination ne se donne à voir, ne devient évidente que chez un seul : Hans Bellmer. Bellmer ne représente pas ce qui est là, mais ce qui persiste; ce qui s’efface vers le fond du miroir ou, peut-être, en remonte. Il pose ce qui a déjà été, ou qui va être, à côté de ce qui est encore : l’autre corps à côté du corps. Mais qui est l’ombre de qui? Il y a simultanément dans l’espace deux images et, ICI, leur résultante qui s’écrit – leur résultante ou l’interférence de leur permutation. La page est comme un miroir, mais elle est seulement analogue à un instant du miroir, d’où l’immobilité de toutes les images, sauf justement chez Bellmer qui, le sachant, leur donne l’air de bouger parce qu’il a eu le génie de jouer de cette instantanéité pour les saisir dans tous leurs états. Le travail de Bellmer pourrait ne fournir qu’un « style » de plus, mais la représentation nouvelle qu’il produit entraîne un certain nombre de conséquences dans les domaines de l’érotisme, de l’écriture, de l’anatomie, du sacré et de l’expérience intérieure. Ces conséquences, bien sûr, ne sont pas séparables, bien qu’il faille les séparer pour les exposer. Mais rappelez-vous d’abord le miroir, et comment votre corps successivement s’y dédouble et s’y retrouve. Rappelez-vous la peur puis l’étrange plaisir quand l’envol et l’effacement de l’AUTRE CORPS vers le fond rendent tout à coup le temps visible comme une ombre – comme le déplacement d’une ombre. Si vous réussissez à fixer ce déplacement, vous entrez dans l’instant, qui est cette image où l’avant et l’après sont là en même temps. Et la tension de tout cela, à l’intérieur de l’instant, fait que l’espace, dirait-on, y est gonflé : qu’il s’érotise tout entier. Cette érotisation est la première loi de l’espace bellmérien. Elle se produit quel que soit le « sujet », car la représentation simultanée de l’espace et du temps (de la trace du temps), en rendant visible le dédoublement du corps ou de l’organe, écrit une persistance dont la simple inscription est égale au désir. Tout autre corps est notre corps pour peu que nous en fassions monter une image. Cette imagination détruit l’identité et sexualise tout ce qu’elle fait apparaître. Dès lors, le sexe n’a pas besoin d’être représenté pour être présent, et s’il est là, c’est plutôt comme un doigt visionnaire habile à déchiffrer la trace, ou bien comme une bouche avide d’être lue. L’image, ainsi, est un piège à temps, et le désir y reste pris. La lire, c’est retourner devant le miroir pour que tout ce qui, déjà, y est apparu recommence. Mais de quelle façon cela s’est-il écrit? L’écriture de Bellmer ne fixe ce qu’elle nous donne à voir qu’en coïncidant absolument avec lui. Elle constitue donc tout ce qu’elle représente. Elle est aussi bien l’acte que son dire. Et il s’ensuit, premièrement, qu’imaginer, c’est agir. Aussi (deuxièmement) faut-il en déduire que ce qui reste-là– le dessin – est à la fois de la trace et du corps. Et qu’écrire, c’est diffuser notre physiologie. Mais chaque geste est une écriture, et peut-être, à force d’en remplir invisiblement l’espace, y créons-nous une sorte d’anatomie inconsciente : un autre corps, dont pages et dessins ne sont, à leur tour, qu’un reflet, une trace. A vivre longuement avec les dessins de Bellmer, on en arrive à la notion de réversibilité généralisée. On est aussi bien celui qui sort derrière le miroir que celui qui reste devant. On y perd son identité. Et que devient alors la pensée – le phénomène pensée? Rien de « spirituel » en tout cas, simplement un élan parmi les organes, une transformation dans leur matière, une éclaircie transparente. Ou peut-être l’expression de la tension entre le corps et l’autre corps : celui qui, à la fin, nous enveloppe tant nous nous sommes projetés dans l’espace – nous enveloppe comme l’air enveloppe l’abîme. A moins qu’au croisement de nos désirs et de notre imagination ne s’écrive, à la longue, quelque enfilade de reflets bonne à nous faire confondre la répétition et l’infini, et à nous faire sacraliser ce petit jeu d’optique. Et si notre corps n’était que le dedans d’un autre corps? Ou bien si nous n’étions que la coque et l’autre l’amande? Mais nous savons maintenant permuter le dedans et le dehors, montrer notre âme aussi bien que notre derrière et en tirer la conclusion qu’il y a une singulière analogie entre l’expérience intérieure et l’exhibitionnisme, entre le silence et la parole, entre le phallus et le vagin : il suffit de les retourner. A la fin, toutefois, il reste deux termes qui ne sont pas réversibles : la vie, la mort. Tout le jeu, peut-être, consistait à l’oublier – à oublier que vous êtes devant le miroir et que, si vous fixez trop longtemps sa surface, c’est une tête de mort qui va remplacer votre tête. Alors, dessiner, écrire, pourquoi encore? Sans doute, comme le dit Bellmer, parce que l’expression est une douleur déplacée : chacun regarde son propre reflet pour ne pas voir l’autre; chacun fait son petit bruit pour couvrir le bruit de la mort. Pas d’œuvres, pas d’art, pas d’idées, pas d’actes, pas de religion, simplement une petite douleur déplacée. Et déplacée – pourquoi pas? – vers l’AUTRE CORPS : celui qui garde la trace des migrations successives de nos désirs. Celui qui est à la fois tout le passé et tout l’avenir, comme chaque femme est la somme de toutes les postures rêvées devant elle aussi bien que déjà connues avec toutes les femmes. Il n’y a pas d’autre fin que la fin, mais la fin même recommence dans le miroir. La putain est un ange et dieu un porc. La petite fille regarde surgir hors de sa bouche basse le sexe d’homme qu’elle rêvait d’y enfoncer. L’homme s’introduit dans son propre phallus à travers celle qu’il aime. Un reflet dépense tous les autres, mais le voyeur parfois en gèle la trace, et c’est un dessin ou un livre. La connaissance, veut-on nous faire croire, c’est la récupération de tout le connu. Mais, dit encore Bellmer, quand tout ce que l’homme n’est pas, s’ajoute à l’homme, c’est alors qu’il semble être lui-même. La connaissance, c’est la révolution du présent : c’est l’autre corps qui se détache du reflet et sort derrière le miroir pour aller baiser l’inconnu."